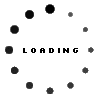Question posée au Ministre Vandenbroucke le 16 juillet 2025. Compte-rendu intégral à retrouver ici.
Monsieur le Ministre,
Une étude anglaise, publiée dans ERJ Open Research s’est penchée sur les conséquences du travail de nuit sur la santé des femmes.
Résultat : les femmes effectuant exclusivement des nuits ont un risque 50 % plus élevé d’asthme modéré à sévère que les femmes travaillant de jour. Ce sur-risque n’est pas observé chez les hommes, quel que soit leur horaire de travail.
Chez les femmes ménopausées sans traitement hormonal de substitution, le risque est presque doublé, augmentant de 89 % parmi les travailleuses de nuit.
Monsieur le Ministre, votre Gouvernement a décidé d’intensifier le travail de nuit en l’étendant à tous les secteurs.
- Quelles politiques de prévention va être mise en place ?
- Les employeurs seront-ils responsabilisés ?
- Une personne ménopausée au chômage sera-t-elle forcée d’accepter un travail de nuit au risque d’être sanctionnée si elle refuse ?
- Les impacts de cette réforme sur la santé de la population seront-ils monitorés ?
Réponse du Ministre :
Vous m’interrogez sur l’impact du travail de nuit sur la santé des femmes. Plus précisément, vous souhaitez savoir si, dans le cadre d’une éventuelle extension du travail de nuit, des politiques de prévention seront mises en place, si les employeurs seront responsabilisés et si une personne ménopausée au chômage pourrait être contrainte d’accepter un travail de nuit sous peine de sanction en cas de refus.
Pour ces trois questions, je vous invite à vous adresser à mon collègue David Clarinval, ministre de l’Emploi, car ces aspects relèvent de ses compétences.
Enfin, vous souhaitez savoir si les impacts de cette réforme sur la santé de la population feront l’objet d’un suivi. À ce sujet, le Conseil scientifique de Fedris effectue une veille active, notamment par le biais de ses différentes commissions médicales, afin d’identifier, le cas échéant, l’existence ou l’émergence de risques professionnels et ce, pour l’ensemble des travailleurs de nuit.
Si un tel risque devait être détecté, le Conseil scientifique de Fedris chercherait à établir des éléments de preuve justifiant les conditions d’un risque professionnel. Le cas échéant, cela pourrait conduire à proposer l’inscription d’une pathologie dans la liste officielle des maladies professionnelles reconnues.
De manière plus générale, le travail de nuit constitue un sujet sensible. Ce n’est pas un hasard s’il fait l’objet de procédures spécifiques, encadrées par une législation stricte. Un débat est actuellement en cours au sein du gouvernement fédéral en vue d’assouplir certains éléments de ces procédures et d’élargir, dans une certaine mesure, le cadre juridique.
Pour ma part, je suis convaincu qu’un minimum de procédures reste indispensable, car le travail de nuit ne peut, en aucun cas, devenir une norme banalisée.
Ma réplique :
Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je suis heureuse de vous entendre quand même traiter ce sujet avec sérieux et ne pas minimiser l’impact du travail de nuit sur la population. Ma question portait spécifiquement sur une étude qui a montré l’augmentation des risques de développer de l’asthme chez les femmes. Mais, on le sait, le travail de nuit a évidemment un impact sur l’ensemble de la population, y compris les hommes.
J’entends chez vos collègues une volonté d’étendre rapidement le travail de nuit à tous les secteurs, avec peu d’encadrement prévu, peu de monitoring. Je compte donc vraiment sur vous pour que, dans les équilibres, il y ait cette attention de la part du ministre de la Santé pour que l’impact du travail de nuit sur la santé soit pris en compte.
Il ne faudrait pas que certaines personnes présentant des facteurs de risque soient contraintes d’accepter un travail de nuit et qu’à défaut, elles soient sanctionnées. C’est en effet quelque chose qu’on ne peut pas normaliser et banaliser vu l’impact.


 Nederlands
Nederlands