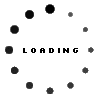Cette proposition de loi a pour ambition d’apporter une réponse structurelle aux crises qui frappent régulièrement le monde agricole depuis plusieurs années. Les revendications des agriculteurs relatives à une juste rémunération de leur travail impliquent un rééquilibrage des rapports de force au sein de la chaîne agricole et alimentaire, ce qui passe par plus de transparence et l’encadrement de certaines pratiques commerciales.
Ces objectifs ne seront pas atteints par les seules mesures annoncées par la taskforce fédérale mise sur pied après les manifestations survenues au début de l’année 2024. Les mesures concernant directement les agriculteurs ont seulement un caractère facultatif, alors qu’il ressort de la pratique qu’une application générale et proactive est nécessaire pour qu’elles produisent des effets.
Vers plus de transparence
L’Observatoire des prix est chargé d’établir un rapport annuel sur la marge réalisée par les différents acteurs de la chaîne agro-alimentaire et les conséquences de son évolution dans le chef de chacun afin d’accroître la transparence au sein de la chaîne agricole et alimentaire. L’Observatoire sera notamment aidé en cela par la nouvelle obligation d’enregistrer les contrats portant sur la première vente de produits agricoles et alimentaires conclus entre un agriculteur et une entreprise, quel que soit le rôle de celle-ci dans la chaîne d’approvisionnement agro-alimentaire (intermédiaire, transformateur ou grossiste), et la faculté de demander tout renseignement ou document utile à son rapport, dans le respect du secret professionnel.
L’obligation de conclure un contrat écrit entre l’agriculteur et l’acheteur est par ailleurs justifiée en tant que telle par le déséquilibre de la relation commerciale entre ces deux parties causé entre autres par le nombre limité d’acheteurs potentiels pour les agriculteurs. Au vu de l’importance d’un secteur agro-alimentaire national sain et du maintien des missions existantes de l’Observatoire des prix, ses moyens doivent également être de toute urgence revus à la hausse en adéquation avec ses nouvelles missions.
La transparence au sein de la chaîne agro-alimentaire sera également accrue en précisant les règles en matière d’étiquetage, dans le respect des règles européennes, pour garantir que les provenances d’un produit agricole et alimentaire et de son ingrédient primaire et son éventuel lieu de transformation soient indiqués de façon identique, que ce soit à l’aide d’un pictogramme, d’un symbole ou d’une description en toutes lettres.
Vers un meilleur encadrement du marché agro-alimentaire
Les pratiques commerciales en vigueur sur le marché agro-alimentaire sont mieux encadrées afin de mettre fin à certaines pratiques qui, directement ou indirectement, privent les agriculteurs d’un revenu juste pour leur travail. C’est pourquoi, d’une part, les promotions sur les produits agricoles et alimentaires seront limitées en valeur et en volume et, d’autre part, la publicité pour ces promotions sera limitée aux points de vente de l’entreprise afin de mettre un frein à la course permanente aux promotions qui est de facto toujours répercutée sur les agriculteurs. À l’inverse, la marge sur les produits non transformés, soit ceux vendus à l’état brut sans ajout d’ingrédients supplémentaires tels que les fruits et légumes, la viande, le poisson, le lait, etc., et sur les produits disposant d’un label de qualité reconnu par une autorité publique sera limitée afin que ces produits qui sont souvent de meilleure qualité pour la santé deviennent plus accessibles pour tous les consommateurs.
Il est également prévu de relever significativement le plafond d’application de la législation transposant la directive (UE) n° 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, afin de protéger un plus grand nombre d’acteurs contre certaines pratiques (déjà) considérées comme déloyales et de facto sont souvent répercutées tout au long de la chaîne.
Enfin, la législation en matière de vente à perte est également renforcée afin d’inscrire sur la liste noire des pratiques commerciales déloyales l’interdiction de vendre des produits agricoles et alimentaires à perte, sous réserve des exceptions prévues à l’article VI.117. L’inscription sur la liste grise décidée par la taskforce fédérale, dont l’application n’est que facultative, est insuffisante pour garantir une saine concurrence sur le marché. D’une part, parce qu’il semble que les fournisseurs de produits agricoles et alimentaires hésitent à porter plainte contre ce genre de pratiques déloyales, parce qu’ils craignent une forme de représailles de la part de l’acheteur3. D’autre part, parce que certains producteurs, qui sont capables d’encaisser des pertes pendant une certaine période dans l’attente de prix plus élevés, entraînent l’ensemble du secteur dans une course vers le bas. Une interdiction facultative n’offre dès lors pas de solution aux revendications principales des agriculteurs, à savoir un revenu juste. Il est également essentiel que les indices de coûts de production qui peuvent servir de référence en matière de vente à perte soient calculés par une autorité publique, une mission qui est dès lors également confiée à l’Observatoire des prix.
Consultez l’ensemble du texte de la proposition de loi en vue de garantir un revenu juste aux agriculteurs ici.


 Nederlands
Nederlands