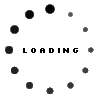Question parlementaire posée le 1 octobre au ministre Prévot. Le compte rendu intégral de la commission peut se trouver ici.
Monsieur le ministre, cette question remonte à plusieurs semaines, dans la foulée d’une rencontre que nous avions eue avec Sensoa qui nous avait informé, grâce à plusieurs témoins, de la situation humanitaire catastrophique à Gaza – laquelle, depuis lors, s’est encore détériorée. Il convient donc de placer cette question dans son contexte.
Cette question portait à l’époque sur la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles à Gaza, enjeu qui découle aussi de la grave situation actuelle. Voici la description qui nous en fut donnée. Seuls sept hôpitaux et quatre centres de soins mobiles assurent encore des soins obstétriques et néonataux, mais aucun ne fonctionne pleinement. Plus de la moitié des médicaments essentiels pour les mères et les nouveau-nés sont en rupture de stock.
Des équipements vitaux tels que les incubateurs ou les échographes sont bloqués aux frontières, tandis que le personnel médical est débordé. Une grossesse sur trois est désormais à haut risque. Deux nouveau-nés sur dix nécessitent des soins spécialisés de plus en plus inaccessibles. La malnutrition maternelle, l’anémie pendant la grossesse et le manque de compléments alimentaires aggravent encore la situation.
Par ailleurs, la pénurie d’eau potable et la destruction des infrastructures d’assainissement favorisent la propagation de maladies infectieuses, y compris évidemment chez les femmes enceintes. La crise affecte aussi gravement la santé menstruelle. Depuis l’imposition du blocus, les produits d’hygiène de base – serviettes hygiéniques, tampons, savon, eau – sont devenus totalement inaccessibles.
Les femmes et les jeunes filles, dont environ 700 000 sont en âge de menstruer à Gaza, vivent leurs règles dans des conditions d’insalubrité et sans intimité; ce qui engendre douleur, isolement et anxiété venant s’ajouter au reste de l’horreur du génocide. Ces enjeux sont trop souvent négligés dans l’aide humanitaire d’urgence, alors qu’ils sont essentiels à la dignité, à la santé et à la survie.
Dans ce contexte, monsieur le ministre,
- Quelle est la part de l’aide humanitaire belge actuellement consacrée aux composantes SSR, y compris la contraception, les soins médicaux et psychologiques pour les victimes de violences basées sur le genre, les médicaments contre le VIH, la santé menstruelle et l’accès à des soins d’avortement sûrs ?
- La Belgique soutient-elle des organisations locales actives dans la santé sexuelle et reproductive à Gaza, avant et pendant cette crise? Si oui, lesquelles ? Dans le cas contraire, des initiatives sont-elles prévues pour en soutenir à l’avenir ?
- Enfin, la Belgique plaide-t-elle activement au sein des instances internationales pour que la santé sexuelle et reproductive soit systématiquement inclue dans l’aide humanitaire vitale, au même titre que l’eau, la nourriture et l’abri ?
Réponse du ministre :
Madame Schlitz, nos partenaires humanitaires, tout comme la Commission européenne, nous informent régulièrement des différents impacts du conflit à Gaza, notamment sur la santé sexuelle et reproductive et plus spécifiquement encore sur l’accès à des produits d’hygiène indispensables aux femmes et aux filles qui, en raison du blocus persistant de l’aide, font cruellement défaut.
Dans notre programme de coopération gouvernemental avec la Palestine, une formation en santé mentale spécifique à la jeunesse comporte un volet consacré à l’amélioration de l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, ainsi qu’au renforcement de la prévention de la violence basée sur le genre.
À cet égard, je m’écarte de la réponse à proprement parler pour vous dire qu’au plus je multiplie les rencontres avec une série d’acteurs clés de nos organes multilatéraux, notamment ceux qui défendent la question de l’égalité des genres et de l’inclusion, au plus je suis effrayé de voir la pression qui est faite sur tous ces acteurs pour progressivement biffer des programmes qu’ils lancent les termes « gender equality » – et je ne vous parle même pas de la question des droits sexuels et reproductifs des femmes pour pouvoir éviter des coupes budgétaires de certaines grandes puissances – et au plus je suis effrayé de l’invisibilisation progressive de ces thématiques qui, heureusement, continuent à être adressées par la volonté qui est déployée sur le terrain, mais avec un cadre de pensée et de décision politique qui est de plus en plus conservateur sur ces questions. Ce n’est pas sans m’interpeller. Je referme la parenthèse, mais, pour avoir eu une discussion récente sur le sujet, notamment avec des responsables de hautes institutions financières multilatérales, c’était l’occasion, à travers votre question, de pouvoir vous partager ma préoccupation.
Pour revenir à l’actualité de votre propos, la politique belge de coopération et d’aide humanitaire privilégie des financements non affectés. Plusieurs de nos partenaires sont actifs dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Je pense au United Nations Population Fund (OMS), à ONUSIDA ou encore au Global Fund, ce qui leur permet d’utiliser leurs ressources au mieux des besoins. Par exemple, le UNFPA a pu intensifier et réorienter son intervention à Gaza, dans la mesure de la possibilité d’accès à Gaza, en collaboration avec ses partenaires locaux. Le UNFPA s’efforce de garantir l’accès à des services vitaux en améliorant la disponibilité des fournitures de santé reproductive, notamment en cas de rupture de stock, pour les femmes enceintes et les jeunes mères. Le réseau de sages-femmes du UNFPA est mobilisé pour offrir un soutien, tout en maintenant les liens avec les spécialistes hospitaliers. Le UNFPA soutient également les lignes d’assistance téléphoniques pour fournir des informations et des conseils aux femmes et aux jeunes. Dans le cadre des prochains financements d’ONG humanitaires, la question de la protection des violences sexuelles, et basées sur le genre, sera prise en compte pour répondre au mieux aux besoins. Dans les instances internationales auxquelles la Belgique participe, nous continuons, pour notre part, de promouvoir plus que jamais un accès universel aux soins de santé et aux droits sexuels et reproductifs, également dans les situations de crise et d’urgence. Je vous remercie.
Ma réplique :
Je vous remercie pour cette réponse et pour les éléments d’actualité que vous avez pu me transmettre. C’est évidemment un contexte que l’on ressent fortement. Nous avons vu la tonitruante suspension du financement de la United States Agency for International Development (USAID) par Donald Trump.
C’est l’un des signes les plus visibles à l’heure actuelle. Il faut en effet rester vigilant, car il n’y a pas que lui. Derrière lui, il y a tout un mouvement d’ampleur, organisé, orchestré et financé, qui vise à démanteler systématiquement les programmes d’aide et de promotion de la santé sexuelle et reproductive, et plus largement, ceux qui œuvrent pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Vous évoquiez les droits sexuels et reproductifs dont on ne parle même pas. Il en est de même pour les droits LGBTQIA+. Je suis heureuse d’entendre qu’à l’international, vous portez une voix résistante sur ces sujets. Il faut continuer à porter cette voix, et continuer à construire un réseau de pays qui, résolument, veulent maintenir une position progressiste en faveur de l’égalité des genres. En effet, aujourd’hui, le contexte est plus qu’alarmant alors qu’il s’agit de droits humains, de dignité et de santé. Je vous remercie pour ces éléments.
Plus globalement, je ne peux qu’insister pour que la Belgique en fasse encore davantage à Gaza sur cet aspect et sur l’ensemble. Je ne peux également qu’espérer que la Belgique puisse assurer la protection des différentes flottilles qui sont en train d’arriver à Gaza, et qui pourraient contribuer à une solution, si elles parvenaient à briser le blocus.
Je tiens à rappeler l’importance de nous engager concrètement dans cette protection.
Je vous remercie.


 Nederlands
Nederlands